Christine Dugoin-Clément est chercheuse à la chaire « Risques » de l’AE Paris-Sorbonne, à l’Observatoire de l’Intelligence artificielle de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au centre de recherche de la Gendarmerie nationale (CRGN). Elle vient de publier un livre Géopolitique de l’ingérence russe.
– Nous sommes la veille du 9 mai, le jour propice pour la désinformation russe. Qu’est-ce que se passe en France ce jour-là, d’une année à l’autre ? Quels sont des outils et des supports de la propagande qu’on voit à l’œuvre?
– Le 9 mai est toujours utilisé par la Russie comme étant un grand moment d’historiographie et de projection de puissance. Un point intéressant, est ce que l’on va faire du Régiment Immortel. Le Régiment Immortel, c’est une très vieille histoire, mais qui est vraiment monté en puissance en 2011-2012 et puis, comme par hasard, en 2014-2015. En 2022, c’est devenu tout un symbole mais qui s’est heurté à la problématique de « l’opération militaire spéciale » : finalement les autorités ont dû interdire que des portraits des hommes disparus en Ukraine depuis l’invasion massive entamée par la Russie ne soient portés aux côtés des portraits des morts pendant la Seconde guerre mondiale. Donc là, la question est de savoir comment est-ce que le Kremlin va gérer les défilés du régiment immortel?
C’est d’autant plus intéressant que c’est un véritable outil utilisé pour disséminer le narratif russe dans plusieurs pays où on pouvait observer de petits défilés du Régiment Immortel. Ces derniers ont d’ailleurs été interdits à partir de 2022, dans plusieurs pays, notamment en Grande-Bretagne. Il est aussi intéressant qu’au Kazakhstan, plusieurs villes aient expliqué qu’ils n’y auraient pas de défilé des Régiments Immortels, motivant cet état de fait par le risque de trouble à l’ordre public. Qu’avons-nous observé alors? Une vague massive de messages sur différents réseaux et différentes plateformes ont fusé, et les Kazakhs ont été pointé du doigt par les Russes quant à ces messages… Il y a quelque chose d’éminemment sensible là-dessus.
Un autre point intéressant, c’est de voir comment seront instrumentalisé les festivités. Le président Zelensky a expliqué qu’il ne pouvait pas garantir la sécurité de l’évènement. De son côté, le président Poutine a annoncé qu’il voulait un cessez-le-feu de quelques jours, ce qui est assez discutable si on pense dans une optique constructive de recherche de solution au conflit car une période si courte ne permet pas une mise en place sérieuse d’une désescalade. Par ailleurs, poser une trêve de manière unilatérale positionne le président russe comme étant le faiseur de règles, tout en lui laissant toute opportunité s’il y a une attaque, – que ça soit une véritable attaque ou ce qu’on appelle une false flag attaque, une Black Ops1- de pousser des attaques sur l’Ukraine dans une approche de représailles, potentiellement en déployant un haut niveau de violence.
Lire aussi: Bernard-Henri Lévy : « L’Histoire a plus d’imagination que les hommes »
Comme chaque année depuis 2022, on est un peu dans l’expectative avant le 9 mai, pour voir ce qui va se passer ou ce qui ne se passera pas, sans parler de toute la « Kremlinologie » faite et qui consiste à analyser qui est assis à côté de qui, où se trouvera Shoigu, où se trouvera Mirochkin et cetera, pour essayer de décrypter des marqueurs de la politique interne Russe.
Un autre point aussi intéressant, dont on a très peu parlé, c’est le concours en Russie lancé en janvier 2025, pour recruter des « architectes sociaux ». Ce concours a été extrêmement populaire : plusieurs milliers personnes ont répondu dans les 48 premières heures. Le niveau de prérequis pour s’inscrire était assez faible, à savoir : avoir plus de 18 ans et être russe. Le concours comportait un examen oral, un examen écrit. Au travers ce concours ce qu’on observe c’est toute une architecture sociale qui se déploie sur la totalité de la Fédération de Russie avec l’idée de prendre un contrôle politique, y compris sur des partis autres que Russie Unie, sous couvert de projets sociaux dans les régions. Cela intervient alors qu’il y aura les élections de la Douma en 2026.
On assiste à un renforcement de toute une chappe sociale, ce qui est renforcé par les déclarations de Kirienko, penseur des annexion et dont le premier cercle s’infiltre sur le sujet de la question arctique, à ce propos, qui laisse entrevoir la volonté d’une nouvelle étape, où les sciences sociales deviennent primordiales. C’est d’autant plus intéressant que le moment est très flottant. D’ailleurs, on parle du prix de la guerre pour la Russie, ce qui est normal car il est très élevé que ce soit en matière de prix économique, mais aussi humain, d’autant que la Russie ne s’est pas montrée être économe de la vie humaine. Mais on s’interroge moins sur ce que serait coût d’une paix stable. Rapatrier de nombreux blessés et traumatisés de guerre, changer le mode de gouvernance des territoires occupés, refaire pivoter l’économie ce sont des points sensibles et on peut s’interroger pour savoir si la Russie serait prête à payer ce type de prix maintenant.
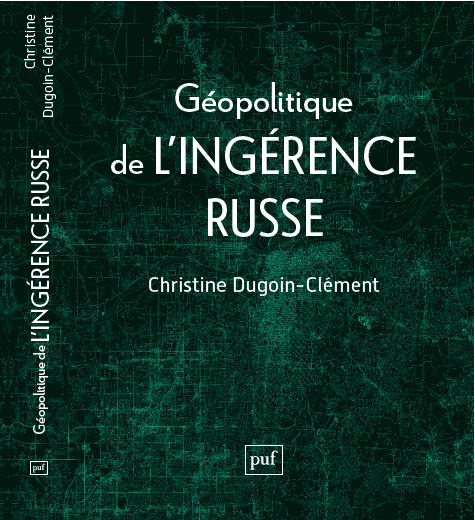
– Au sujet de instrumentalisation des jeunes. Dans ton livre qui vient de sortir, Géopolitique d’ingérence russe : la stratégie du chaos, tu racontes que le jeu Pokémon Go était instrumentalisé et piraté de l’intérieur par la Russie. C’est uniquement sur les territoires des États-Unis ou un peu partout dans le monde ?
– Ils l’avaient surtout centré pour une action qui visait les États-Unis à ce moment-là, mais ce qu’on a fait sur une période donnée, on peut le refaire ailleurs et plus tard. Pour rebondir sur ton propos, la mobilisation des jeux vidéos est une approche maintenant fortement déployée. Il y a eu la création de différents jeux, il y a eu le déploiement d’Africa Down sur le continent africain, en juillet de l’année dernière, qui a été soutenu par l’Initiative Africaine, structure que l’on peut relier à Moscou.
À cette occasion, Grisha Poutine, un streamer assez connu, a été invité pour faire le lancement d’Africa Dawn. Il s’agit d’un jeu de stratégie, fortement inspiré de Heart of Iron IV. On peut y jouer un gouvernements d’un pays de la bande sahélienne, pour prendre des décisions stratégiques. Là où cela devient problématique, c’est que le contexte est distordu pour coller au narratif russe, ce qui n’est pas normalement le cas.
Par exemple, dans Heart of Iron, on peut décider de jouer un pays différemment de ce que l’histoire a montré et le faire gagner, mais le contexte de départ va reprendre des faits historiques avéré. Ce n’est pas le cas dans la version russe du jeu où on parle de la libération de la colonisation française. C’est ce qu’on avait aussi vu avec Best of Hell qui permet de jouer un soldat russe en Ukraine, en reprenant tout le narratif russe sur les raisons de rentrer dans le conflit, notamment les violences faites aux russophones, etc. Et on a maintenant d’autres déploiement y compris sur Roblox et Minecraft qui vont viser un public beaucoup plus jeune, de pré adolescents et d’adolescents. Là, on tente d’influencer les perceptions des plus jeunes : on prévoit le coup d’après, voir le coup d’après-après. L’approche d’influence russe peut être à la fois et très opportuniste et profitant d’une perturbations momentanée et simultanément travailler sur du temps long.
Lire aussi: Kara-Murza, un opposant russe au subconscient impérial
Il y a aussi une utilisation de l’e-sport. Il y a aussi une compétition pour les 16-18 ans qui va rejouer la prise d’assaut de Marioupol par des tunnels souterrains en reprenant une partie du jeu Squad 22 : ZOV. Il y a vraiment et un travail tourner vers la mise en place d’ancrages mémoriels qui vont coller à l’historiographie que porte le Kremlin, tout en utilisant des compétences pour détecter des talents qu’on pourra potentiellement recapitaliser ensuite.
Ce que cela montre, c’est une énorme adaptabilité de la machine informationnelle aux nouvelles technologies, à de nouvelles plateformes, notamment dans le but de suivre un large spectre de type de population. Il y a une mutation qui se fait pour accentuer la capacité « traquer la cible » et pour déployer des moyens de toucher des populations jusqu’alors difficiles d’accès. Cela permettra de gagner du temps et de l’énergie à un horizon de 5,10 ans.
– Est-ce qu’on peut dire que, par exemple, les adolescents français sont visés aussi par cette tentative de récupération par la Russie, directement ou indirectement, à travers les jeux vidéo ?
– Il est possible d’accéder à ces jeux, mais pour l’instant on est encore au début et certains ne sont pas en français. Ce qui est notable c’est aussi que les autorités russes font passer la création de ces jeux pour des initiatives autonomes, menées par exemple par des écoliers dont un membre de la famille est sur le front en Ukraine quand on parle de Minecraft. L’histoire peut être vrai, mais quand on regarde les financements, on voit le soutien de structures étatiques. En matière de cible, il y a eu un intérêt clair sur le continent africain, avec un jeu taillé sur mesure.
Il y a aussi une autre utilisation qui va viser l’Ukraine et qui rappelle le système de récompense promis sur Pokemon Go. Avec les jeux, il y a une pénétration forte et il y a des tentatives de faire faire une action dans le monde réel contre une récompense utilisable dans le jeu (des bons, ou autres bonus). Or, les enfants à qui on va faire cette proposition alléchante ne réalisent pas forcément les conséquences de ce qu’ils font. Ça peut être des petites actions du type allumer un feu à un endroit précis, sauf que c’est cet endroit ne sera pas anodin. En jouant sur des enjeux de gamification avec des enjeu de récompense, il y a le pari que les cibles agiront quasi automatiquement, sans bien réaliser la portée de leurs actions.
– Qu’est-ce qu’on peut faire actuellement pour contre-agir, pour essayer de réduire l’impact de cette influence ?
– C’est la grande question. Jusque-là, il y avait tout un travail important de démystification, de débunkerisation, en mobilisant des ressources d’Osint et de fact-checker… Cela reste nécessaire pour des gens qui sont un peu dans le doute et qui cherchent à comprendre, qui ont envie de vérifier. Le problème c’est que c’est extrêmement chronophage, que l’on fait face à une masse énorme et que cela ne suffit pas forcément à contrecarrer l’implantation de narratif. Cela d’autant plus quand des puissances ne parlent plus de vérité, mais proposent une vision du monde qui est la leur. C’est notamment ce que l’on rencontre quand des gouvernements pivotent et adoptent une approche extrême antisystème, anti-européen, etc. Dans ces cas, ils annoncent leur vision du monde. L’efficacité fact-checking risque d’être limitée, il faut certes absolument continuer d’en faire, mais on ne doit pas uniquement se reposer sur cette pratique.
– C’est nécessaire mais pas suffisant alors ?
– Parfois c’est un peu comme quand on fait un bruit blanc en audio. Quand on met un casque et qu’on tape sur l’oreillette pour activer le mode silence, en fait, ce n’est pas silencieux. On envoie un bruit qui neutralise le bruit extérieur. Et c’est un peu ce qu’on peut avoir parfois avec le fact-checking. On arrive à un bruit blanc, à une neutralisation, mais ce n’est pas assez pour avoir une protection plus forte. L’idée est de se demander ce que nous sommes capables de déployer comme bouclier, quelle est notre histoire ? Je ne parle pas de narratif, mais quasiment de communication stratégique. Un des problèmes est si on ne raconte pas notre propre histoire, quelqu’un d’autre va le faire pour nous. Sauf que si on ne choisi ni le script, ni le scénariste, ni le réalisateur, ni les acteurs, il y a des chances que le résultat ne réponde pas à nos attentes, surtout si ces derniers sont choisi par des puissances hostiles. La question elle est là, que sommes-nous en capacité de produire sur ce que nous sommes ? La Russie nie toute existence à l’Ukraine. Il y a eu beaucoup de travail de fact-checking pour contrecarrer cela, mais au-delà l’Ukraine – qui travaille maintenant à expliquer ce qu’elle est, son existence en tant que tel, sa culture, son histoire, pour dire : nous existons, – ce qui va à l’encontre du narratif russe qui dit qu’il s’agit d’un non-pays et donc un non-problème et d’une non-guerre.
Cela demande un vrai travail d’introspection et de transversalité, avec les différentes sphères de la société civile. C’est un travail global. De son côté que fait la Russie ? Il y a eu plusieurs étapes. D’abord elle va créer du faux avec du deepfake, puis, elle va instrumentaliser du vrai, et puis envoyer tellement de choses que l’on ne sait plus quoi croire. L’idée ne sera plus forcément de vous persuader, mais de ne plus permettre d’accorder sa confiance à quoi que ce soit. Ce n’est plus uniquement croire à un mensonge, c’est ne plus croire à rien, ni en rien. C’est tout aussi nocif au final. Parce que s’il y a ce doute perpétuel, les individus n’arrivent plus à faire corps, à former un groupe social qui s’entend sur un certain nombre de points et qui peut ne pas être d’accord sur l’autre, – c’est le principe de la démocratie, – mais qui permet néanmoins d’avoir une base suffisamment unifiée et solide pour prendre une décision potentiellement difficile qui peut impliquer de poser des actions qui ne sont pas forcément faciles.
– L’identité européenne avec tous ces résonnements, comment tu la définis ? Qu’est-ce que nous sommes ? Est-ce qu’elle existe déjà, cette identité, avec telle variété des cultures, des langues, des religions, des traditions ?
– C’est un des gros enjeux. Avec l’arrivée de la nouvelle administration Trump, il y a eu un moment de stupeur et de tremblement, et plusieurs pays européens se sont dit qu’ils allaient devoir se constituer comme étant pus autonomes de la puissance américaine. Cela n’empêche pas d’avoir des éléments de discussion, et une politique de discussion : c’est même le but de la diplomatie, sans pour autant s’aligner sur toutes les décisions. Que la France sur les questions de défense engage des discussions avec les britanniques qui ont brexité, et avec la Norvège, est intéressant car on est plus uniquement sur l’échelle de l’Europe institutionnelle. C’est d’autant plus pertinent que l’on sait qu’il y a des points bloquants ou a minima difficiles entre les différents membre de l’UE, notamment avec la Hongrie de Viktor Orban, très proche des visés géopolitiques du Kremlin. On voit que les lignes bougent, on ne s’interdit pas une approche pragmatique.
– Comment tu vois l’avenir de la défense européenne et la sécurité de l’Europe, dans le futur proche, avec l’isolationnisme américain d’un coté et l’agressivité russe d’un autre?
– Au lendemain de la 1ere élection de Donald Trump, il y a eu ce premier effet d’affolement que l’on peut résumé en « Nous allons être seul! ». Ensuite, quand le président Biden est arrivé au pouvoir, il y a eu un moment de respiration. Tout le monde l’a trouvé évidemment sympathique. Avec les dernières élections on s’est retrouvé sur le même effet de stupeur. Ça ne veut pas forcément dire qu’on restera dans des relations tendues dans la ou les décennies à venir, mais cela montre qu’il est important de réaliser qu’il faut avoir une capacité d’autonomie à un moment où nous avons dû opérer un grand changement dans notre hiérarchisation des menaces.
Pour mémoire, après l’effondrement de l’URSS, les armées occidentales, notamment européennes, avaient conçu leur modèle sur une hiérarchisation des menaces sur le principe de risque asymétrique d’origine majoritairement terroriste ou para étatique en se disant que le modèle des conflits à venir ne serait pas celui connu préalablement : on aurait probablement pas de conflit sur le territoire national, on ferait majoritairement face à des conflits asymétriques et pas à une guerre traditionnelle de haute intensité. Or avec l’invasion de l’Ukraine et même si l’usage des drones et une grande nouveauté, on retourne sur un modèle de guerre plus traditionnel, avec les tranchées, des combats d’artillerie, du minage, des dents de dragon…
Lire aussi: Nicolas Tenzer : « La victoire de l’Ukraine est toujours possible »
On est en train de faire ce pivot, ce qui veut dire : relancer une industrie de défense, ce qui implique des investissements, de former des compétences, et de sécuriser les chaînes de valeur et tout ce qui relève de la « supply chaîne » … C’est la prise de conscience que l’on voit à l’heure actuelle. On change la hiérarchisation des menaces ce qui se voit aussi dans la montée de l’influence comme étant une priorité stratégique. Or l’influence est quelque chose de complexe, parce que protéiforme. Ce n’est pas une question qui peut être traitée uniquement par une composante mais qui doit vraiment se penser en transversalité.
– Pourquoi Macron a mis autant de temps à dire noir sur blanc que la Russie représente un danger pour la France?
– Ce qui est important, c’est que cela soit fait et comment. Aujourd’hui les choses sont posées clairement sur la table. Les déclarations qui ont pu être faites, les déclarations fermes, ont à chaque fois eu comme conséquence un renforcement d’attaque informationnelle, voir d’attaque cyber. Je pense que il y a aussi tout une approche diplomatique qui a été de tenter de garder une couloir de discussion ouvert, avec in fine une prise de conscience de la valeur de la parole russe. Régulièrement, on a pu mettre en avant les manquement de la parole du gouvernement russe. Dernièrement on en a eu l’illustration au sujet des armes chimiques, qui sont interdites et dont l’usage en Ukraine a été largement référence par l’OIAC. Il y a eu une vraie dévalorisation de la parole russe, avec néanmoins une certaine ambiguïté, certains disaient avec justesse : « mais le président Poutine a annoncé ce qu’il voulait faire dès 2007! »
– C’est vrai, tout a été dit en conférence de Munich…
– Oui, mais ça, on n’a pas voulu le croire, il y a parfois une aversion au risque. On veut parfois essayer de croire qu’il y restera une capacité de négociation parce qu’on se fonde sur un paradigme de pensée qui est le nôtre. On ne veut pas croire ce qui nous semble être du déclaratoire incohérent avec notre perception du monde, notre perception de la force. Et cela rentre mieux dans nos cadres de se dire que quand on a signé un accord, un traité, ou un agrément, qu’on les a ratifié, on va les respecter… Or si c’était le cas, avec la charte de l’ONU, il n’y aurait pas eu l’invasion de l’Ukraine. La Russie joue également beaucoup sur le déni plausible.
– Un des fakes news russe que a bien marché pour les Français, c’est une affirmation que « à cause de l’Ukraine le gaz et l’électricité ont augmenté ». Cet « argument » ressort régulièrement. Pourquoi, à ton avis ?
– Ce qui n’aide pas, c’est l’accélération du temps. On est habitué à être hyperconnecté et à réagir plutôt qu’à réfléchir. Le problème c’est que réfléchir prend du temps, demande des efforts. En plus quand quelque chose vous touche de manière directe avec un impact émotionnel il est difficile de prendre le temps de réfléchir. Ce qui est intéressant, c’est qu’on a très souvent une inversion de la parole. C’est-à-dire qu’on va prendre un petit peu de vrai, un petit peu de faux et on va le mélanger, ce qui apporte de la crédibilité.
Typiquement : le prix du gaz a augmenté. Pourquoi ? Parce qu’on avait une dépendance au hydrocarbures russes et que la Russie est entrée dans une guerre d’invasion, et que de facto, on a eu des sanctions et une augmentation du prix du gaz. Pourquoi ? Parce qu’un état n’a pas respecté les chartes et traités qu’il avait lui-même signé. Pourtant on arrive à une inversion dans la propagande russe qui prend notamment la forme d’un discours selon lequel, c’est de la faute des européens et de leur politique agressive que le prix du gaz et du pétrole augmente. C’est ce type d’inversion que l’on avait eu avec le discours selon lequel la Russie a été « obligée » de mener cette « opération militaire spéciale » sur le territoire ukrainien. En règle générale l’influence va travailler sur tout ce qui est clivant, et polarisant, sur tout ce qui pourra renforcer les approches antisystème et la perte de confiance, en y ajoutant une charge émotionnelle. Nous pouvons tous en être victime, au travers un sujet sur lequel on sera plus ou moins sensible, ou plus ou moins bien informé.
– Comment rendre la population moins crédule, comment former rapidement les gens qui ont déjà terminé leurs écoles pour qu’ils reconnaissent où est le fake et où est la vérité ?
– Être conscient qu’on est faillible c’est quelque chose d’important. Il y a d’autres souci : la perte de confiance le fait de ne plus accorder sa confiance n’a personne et de plus adhérer à une vision qu’a des faits. En étant sincère, prendre du recul dans un monde qui s’accélère n’est pas tâche aisé, c’est plus facile et rapide de lire 5 ou 10 tweets qu’un article académique de 25 pages par exemple.
– Dans ton livre tu dis qu’il est extrêmement difficile de mesurer l’impact de propagande, des fosses nouvelles, des deep fakes… Mais comment on distingue des opérations réussies et pas ?
– Ce qui est difficile, c’est que quand on est la victime de l’attaque, on est réactif. Donc déjà, on s’aperçoit de l’attaque quand elle a déjà lieu. Or, pour mesurer ses effets, il faudrait avoir un état de la perception avant l’attaque pour ainsi faire des mesures avant, pendant. C’est évidemment plus facile quand on est l’attaquant, parce qu’on sait qui on va viser, quand et comment on va le viser, et l’intérêt d’une opération informationnelle : c’est toujours de passer ses comportements et attitudes du monde numérique au monde réel.
Cependant et même si on n’a pas cette mesure de l’effet réel de telle ou telle action, le simple fait de dire « J’attaque une puissance ou une autre », d’un point de vue informationnel, permet de faire passer un message à des tiers, notamment à d’autres états qui peuvent se sentir mal traités et désalignés avec la puissance attaquée. En osant attaquer, en poussant un narratif proche des attentes de ces états, la Russie se présente comme une alternative crédible.
On a évoqué l’approche opportuniste qui consiste a capitaliser sur la survenance d’un événement même imprévu. On va alors surfer sur l’émotion, les mécontentements, les polarisations. On va souffler sur les braises, parce qu’on ne part pas de rien. On ne part jamais de rien. En parallèle, il y a ce travail qui se fait sur du long terme par exemple en tissant des liens avec différents partis radicaux, en poussant des idées nationalistes, isolationnistes et cetera. Le problème est d’arriver à mesurer, quel va être l’effet sur des populations des actions de long terme sur la perception qu’ils auront du monde et sur le rôle facilitateur que cela aura lors d’actions opportunistes.
En termes d’outils, on est vraiment spectre large, il y a les actions de terrains, les réseaux sociaux, les faux sites d’information les jeux vidéo, les films… Récemment, The Witness n’a certes pas rencontré le succès escompté mais néanmoins. Il y avait d’autres opus notamment réalisé par la société Arun de feu de Evgueni Prigojine. Parallèlement, il existe une série qui reprend les principes des gangs juste dans la fin des années 90 dans la région Kazan, avec des jeunes en hyper violence, qui a été très populaire et qui reprend la culture carcérale de l’AYE pour la romantiser. On a ici une sorte de romantisation d’une extrême violence. On pourra noter que la série sort et rencontre le succès à un moment où l’on peut déjà observer le coût social des hommes qui sont revenus d’Ukraine avec des PTSD et avec un potentiel de violence décuplé. Une question ouverte est de se demander si ce type de production habitue la population au potentielles recrudescences de violences induites par ces retours.

